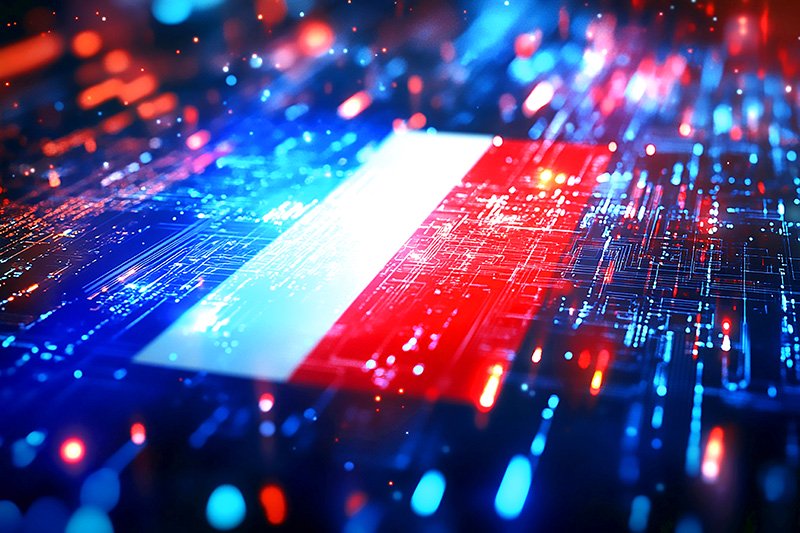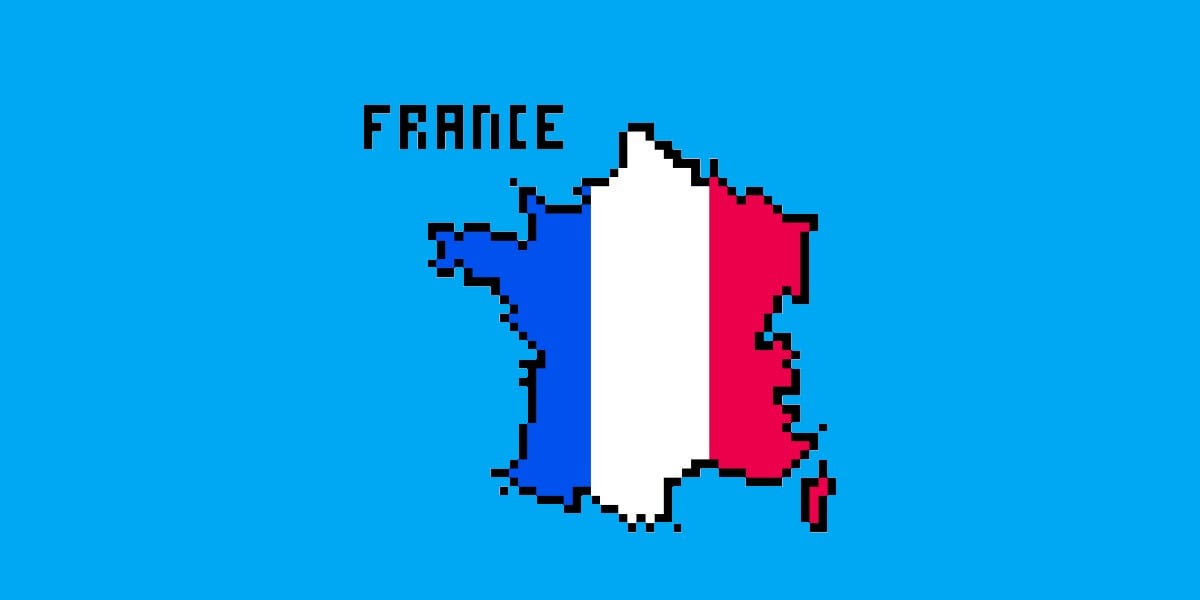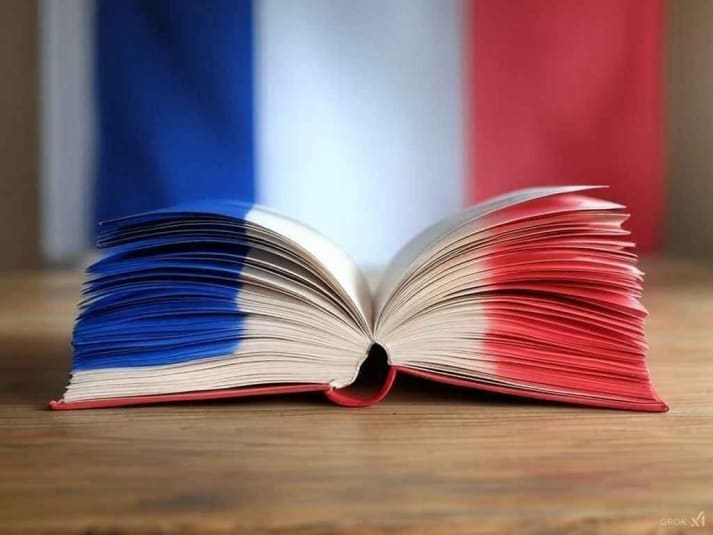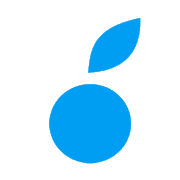Souveraineté numérique : les collectivités locales se libèrent des GAFAM grâce à l’open source
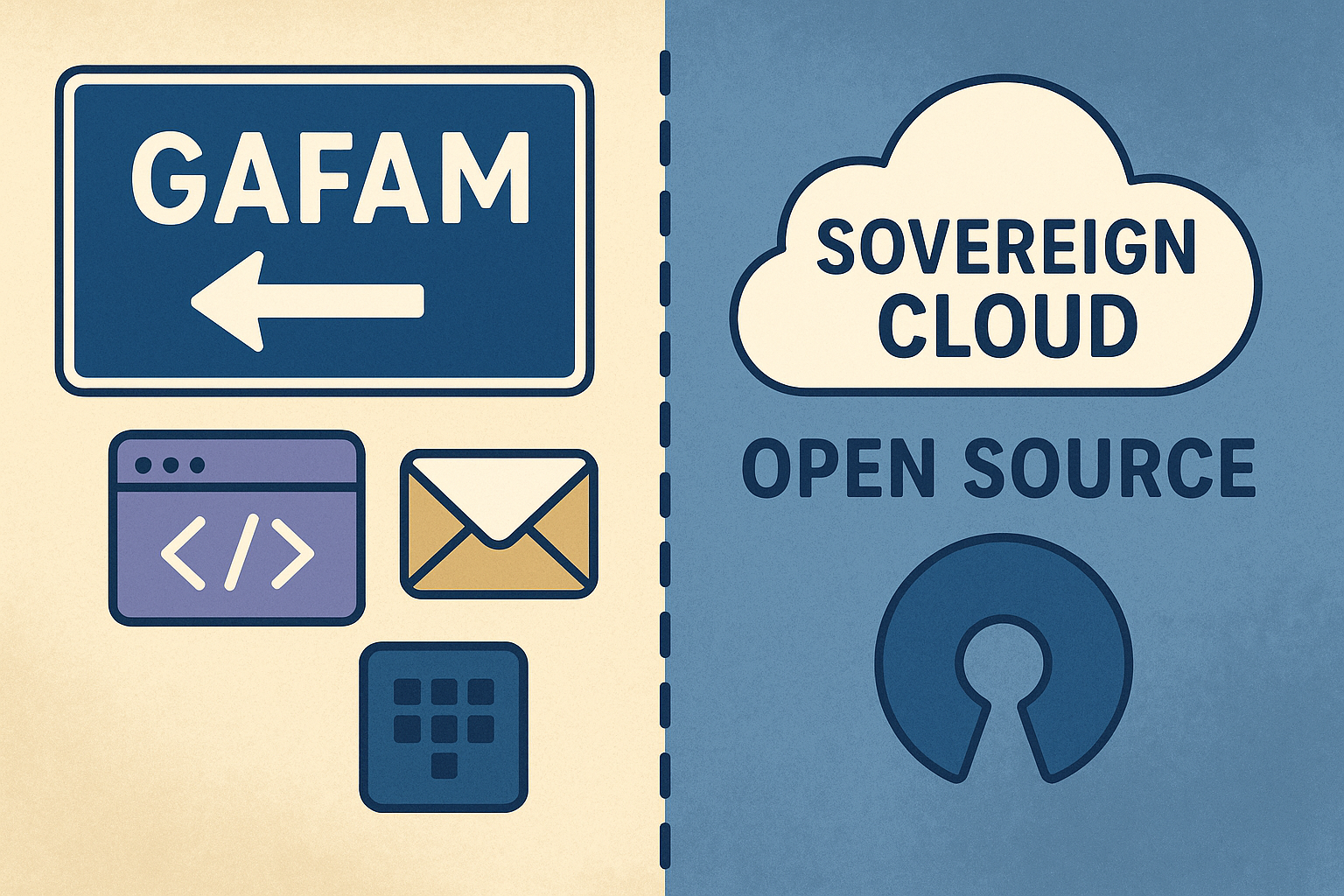
Un véritable mouvement de fond s’observe depuis peu : de plus en plus de collectivités locales (villes, régions…) en France et en Europe disent adieu aux logiciels des géants du numérique américains (les GAFAM) pour adopter des solutions open source. Ce virage n’est pas anodin : il répond à des enjeux stratégiques de souveraineté numérique, de sécurité des données et d’indépendance technologique. La ville de Lyon, par exemple, a annoncé en juin 2025 une transformation majeure de ses outils numériques afin de ne plus dépendre des solutions logicielles états-uniennes. Cette tendance touche aussi d’autres acteurs publics (ministères, régions) et même des entreprises privées soucieuses de reprendre le contrôle de leurs données. Pourquoi un tel exode loin des GAFAM ? Comment ces organisations parviennent-elles à basculer vers l’open source ? Quels gains en retirent-elles et quels risques doivent-elles anticiper ? Nous vous proposons un tour d’horizon détaillé et technique de cette évolution.
Pourquoi abandonner les solutions des GAFAM ?
Souveraineté, loi et contrôle des données
Le premier moteur de ce « désengagement » est la quête de souveraineté numérique. En utilisant des logiciels propriétaires américains (Microsoft 365, Google Workspace, etc.), les organisations européennes s’exposent à la juridiction extraterritoriale des États-Unis. En effet, des lois comme le Cloud Act ou le FISA (héritier du Patriot Act) permettent aux autorités américaines d’accéder aux e-mails, documents et bases de données d’une organisation française hébergés sur des serveurs Microsoft, Google ou autres, sans recours possible de la France. Cela pose un sérieux problème de confidentialité et de souveraineté des données : des informations sensibles (données personnelles de citoyens, documents stratégiques, recherches) pourraient être consultées par un gouvernement étranger sans autorisation. Pour une collectivité ou une entreprise traitant des données critiques, c’est inacceptable.
Au-delà du risque juridique, dépendre de suites américaines signifie perdre la maîtrise de l’infrastructure et du stockage. Où sont hébergées nos données ? Qui y a accès ? En choisissant des alternatives open source hébergées localement ou sur des clouds souverains, les collectivités s’assurent de décider où et comment leurs données sont stockées et protégées. Par exemple, le Land allemand du Schleswig-Holstein a entrepris de migrer ses données vers un cloud public allemand plutôt que d’utiliser les services de Microsoft ou Google. Cet enjeu de contrôle a été mis en lumière par les tensions géopolitiques récentes : les relations UE–USA, la guerre en Ukraine, etc., ont rappelé l’importance de ne pas dépendre d’acteurs étrangers pour des ressources stratégiques (énergie hier, numérique aujourd’hui).
Enfin, les pouvoirs publics cherchent à garantir la conformité au RGPD et aux doctrines nationales de sécurité. En France, la doctrine Cloud de l’État exige que les données sensibles des administrations soient hébergées par des solutions certifiées SecNumCloud (sécurisées et hors portée juridique non-UE). Or, les suites collaboratives américaines ne respectent pas ce critère de « cloud de confiance ». Passer à des logiciels libres ou des clouds européens permet de mieux se conformer à ces exigences légales et de protéger la vie privée des citoyens.
Indépendance technologique et économique
Le deuxième grand motif, c’est de sortir d’une dépendance technico-économique de plus en plus contraignante. Les GAFAM pratiquent le vendor lock-in : une fois qu’une organisation a adopté leur écosystème (Windows + Office + Teams, ou Google Docs + Gmail, etc.), s’en affranchir semble complexe et coûteux. Les outils sont interconnectés, les données piégées dans des formats propriétaires… Cette captivité numérique peut durer des années si l’on ne fait rien, avec à la clé une dépendance subie aux décisions du fournisseur.
Dépendre d’un seul éditeur présente aussi un risque financier. Microsoft, pour ne citer que lui, profite de sa position dominante pour augmenter régulièrement ses tarifs en Europe. Dernièrement, l’intégration de fonctionnalités d’IA a servi de prétexte à une hausse de prix pouvant aller jusqu’à +43 % sur l’abonnement Microsoft 365. À chaque nouvelle version, certaines options gratuites disparaissent, poussant les administrations à payer toujours plus. Ces hausses imprévues pèsent sur les budgets publics, comme l’a souligné un expert : « Les administrations se retrouvent parfois prises à la gorge » par les coûts des licences propriétaires. Au contraire, les logiciels libres n’imposent pas de licence payante par poste ; les dépenses se limitent au support, à la maintenance et à la formation, ce qui s’avère bien souvent moins coûteux sur le moyen terme. Le Land de Schleswig-Holstein anticipe ainsi plusieurs dizaines de millions d’euros d’économies en passant à l’open source.
Au-delà des coûts, il y a aussi un risque géopolitique à cette dépendance. En cas de tensions internationales ou de changement de politique aux États-Unis, un éditeur comme Microsoft pourrait restreindre l’accès à ses services, ou appliquer des conditions désavantageuses aux clients européens. Ce scénario peut sembler extrême, mais il est évoqué sérieusement depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025. Dans ce contexte, de nombreuses collectivités préfèrent prendre les devants : ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier technologique et diversifier leurs outils. Cela s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique européenne plus large : l’Union européenne encourage le développement de capacités numériques souveraines et la réduction de la dépendance aux fournisseurs extra-européens. L’Agence nationale de la cohésion des territoires en France finance par exemple des suites collaboratives libres pour les collectivités (cf. plus loin le cas Territoire Numérique Ouvert) afin de stimuler une offre locale et indépendante.
Sécurité, transparence et innovation
Contrairement à une idée reçue, les logiciels libres offrent des garanties en matière de sécurité et de transparence. Le code source étant ouvert et auditable, une communauté d’utilisateurs et de développeurs peut repérer et corriger rapidement les failles, assurant une protection robuste de l’outil. Pour les collectivités, cette transparence est un gage de confiance vis-à-vis des citoyens : une ville qui passe à des logiciels libres offre à ses habitants une visibilité sur les algorithmes utilisés dans les services publics. Cela rejoint un impératif démocratique : expliquer les traitements automatisés et algorithmes qui prennent des décisions (par exemple dans l’attribution de prestations sociales, le calcul des impôts, etc.). Avec du code ouvert, il devient possible de vérifier le fonctionnement des logiciels publics, ce qui renforce la confiance et la redevabilité.
L’open source rime aussi avec interopérabilité et pérennité. Les formats ouverts garantissent un accès à long terme aux documents et données, sans risque de se retrouver avec des fichiers illisibles suite à l’abandon d’un logiciel propriétaire. Pour l’archivage historique des collectivités, c’est un atout important : conserver la maîtrise de ses données sur des décennies, voire plus, en pouvant toujours relire les contenus car on dispose du code source et des formats ouverts nécessaires. De plus, une collectivité peut mutualiser ses efforts avec d’autres autour d’un même outil libre : par exemple développer en commun une application qui servira à plusieurs villes (portail citoyen, système de délibérations, etc.), ce qui répartit les coûts et profite à tout un réseau d’utilisateurs.
Enfin, adopter les logiciels libres encourage l’innovation locale. Plutôt que d’acheter une solution clé-en-main à un géant étranger, les collectivités qui investissent dans l’open source collaborent souvent avec des PME locales, des éditeurs nationaux ou la communauté open source. Cela développe les compétences internes (on devient acteur du logiciel, pas simple client passif) et soutient l’écosystème numérique local. La France et l’Europe ne manquent pas de talents dans le domaine : en privilégiant ces solutions, le secteur public agit comme un moteur pour faire émerger des alternatives compétitives. D’ailleurs, l’État français a lancé La Suite Numérique, un projet collaboratif open source à destination des agents publics, montrant bien la volonté d’offrir une alternative souveraine aux outils collaboratifs privés. De même, l’Allemagne a voté une loi imposant aux administrations fédérales de privilégier le logiciel libre dans leurs achats informatiques, et la Suisse exige désormais que tout nouveau logiciel développé pour l’État voie son code source publié (sauf exception de sécurité). Ces exemples soulignent que le logiciel libre est désormais considéré comme un pilier stratégique de la souveraineté numérique en Europe.
Comment opérer la transition vers l’open source ?
Convaincre de la nécessité de changer est une chose, passer à l’acte en est une autre ! Migrer tout un parc informatique et des milliers d’utilisateurs vers de nouveaux outils représente un défi technique et humain. Cependant, plusieurs collectivités pionnières ont montré la voie, fournissant des retours d’expérience précieux sur le « comment ».
Choisir des alternatives libres performantes et compatibles
La première étape est d’identifier les solutions open source équivalentes pour chaque usage aujourd’hui couvert par un logiciel propriétaire. Bonne nouvelle : en 2025, il existe des alternatives libres matures pour tous les besoins courants :
- Systèmes d’exploitation : Remplacer Windows par une distribution Linux adaptée. Par exemple, la ville de Lyon a commencé à déployer Linux sur les postes de travail municipaux à la place de Windows. En Allemagne, le Land de Schleswig-Holstein prévoit également d’abandonner Windows pour Linux d’ici quelques années, après une phase initiale centrée sur la bureautique.
- Suite bureautique (Office) : Remplacer Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint…) par une suite libre telle que LibreOffice ou OnlyOffice. Lyon a opté pour OnlyOffice pour ses agents, tandis que le ministère du Numérique danois a commencé à déployer LibreOffice en 2025 sur la moitié de ses postes, avec l’objectif de l’imposer partout d’ici fin 2025. Ces suites libres permettent de créer des documents texte, tableurs et présentations tout en assurant une compatibilité avec les formats Microsoft (DOCX, XLSX, etc.). OnlyOffice, par exemple, offre une interface proche d’Office et une bonne prise en charge des fichiers Office pour faciliter la transition.
- Messagerie et agenda : Remplacer Outlook/Exchange. Des solutions open source existent, comme Thunderbird (client mail) couplé à un serveur tel que BlueMind, Zimbra ou Open-Xchange pour la gestion du courrier, des calendriers et contacts en mode collaboratif. Le Schleswig-Holstein a retenu l’ensemble Open-Xchange + Thunderbird pour remplacer Outlook. Ces outils permettent d’assurer la continuité du service de messagerie interne et la synchronisation des agendas, souvent via des protocoles ouverts (IMAP, CalDAV…).
- Stockage de fichiers et collaboration : Remplacer OneDrive/SharePoint ou Google Drive par des solutions comme Nextcloud ou Seafile. Nextcloud, en particulier, est très populaire en Europe pour créer un cloud privé ou hybride : il offre partage de fichiers, synchronisation multi-appareils, co-édition de documents en ligne, messagerie instantanée, etc., avec de nombreux modules additionnels. Le Land de Schleswig-Holstein utilise Nextcloud comme substitut à SharePoint, et la ville de Lyon déploie également une plateforme collaborative basée sur Nextcloud et d’autres composants libres dans le cadre de son projet Territoire Numérique Ouvert.
- Visioconférence et messagerie d’équipe : Remplacer Teams, Zoom ou Google Meet par des outils libres tels que Jitsi (visioconférence), BigBlueButton (conférences en ligne, e-learning) ou Mattermost / Element (Matrix) pour la messagerie instantanée d’équipe. La suite Territoire Numérique Ouvert (TNO) développée pour les collectivités lyonnaises repose justement sur un bouquet d’outils open source couvrant la visioconférence et la co-édition bureautique. Cette suite collaborative libre, hébergée dans des datacenters de la région Auvergne–Rhône-Alpes, propose des fonctions comparables à Microsoft 365 (visioconf, partage de documents, édit docs en ligne) tout en étant interopérable avec les formats standard.
- Applications métiers : C’est un volet parfois invisible pour le public, mais les collectivités utilisent de nombreux logiciels métiers (gestion financière, ressources humaines, élections, cartographie SIG, etc.). Là aussi, il existe souvent des solutions libres ou open source soutenues par des communautés ou associations (par exemple, l’ADULLACT propose des logiciels libres pour les besoins spécifiques des mairies : gestion d’état-civil, cimetière, listes électorales, etc.). Au besoin, les collectivités peuvent même développer en interne ou en groupement une application sur-mesure, dont le code sera partagé et mutualisé. Cette approche collaborative est facilitée par le modèle open source, comme le montre le cas de Lyon et du SITIV (syndicat informatique regroupant plusieurs villes) qui ont co-développé Territoire Numérique Ouvert pour en faire bénéficier d’autres communes.
L’important est donc de cartographier les besoins et d’identifier pour chaque brique propriétaire l’équivalent libre approprié. Dans la plupart des cas, on trouve son bonheur dans l’écosystème libre, parfois en acceptant quelques ajustements (un logiciel unique GAFAM pouvant être remplacé par plusieurs outils spécialisés côté libre). Ce travail de sélection peut s’appuyer sur des ressources comme le Socle Interministériel de Logiciels Libres (SILL) publié par l’État, qui liste des logiciels libres recommandés pour chaque usage au sein des administrations. On bénéficie ainsi du recul d’autres utilisateurs publics avant de faire son choix.
Méthode progressive et accompagnement des utilisateurs
Une erreur à éviter serait de basculer du jour au lendemain l’ensemble des utilisateurs sur les nouveaux outils, sans préparation. Les collectivités ayant réussi leur transition ont adopté une approche progressive et pilotée. Par exemple, la Danish Agency for Digitalisation a commencé par équiper 50% des agents en LibreOffice le premier mois, tout en maintenant Office 365 pour l’autre moitié, afin de tester et d’ajuster avant d’étendre à tout le ministère. De même, la région Occitanie en France a choisi une stratégie par étapes : elle a d’abord remplacé la messagerie et la suite collaborative, puis envisage de continuer avec d’autres logiciels coûteux comme la bureautique, plutôt que de tout changer en même temps.
Voici quelques bonnes pratiques pour une transition en douceur :
- Audit et planification : d’abord, réaliser un audit des outils en place et de leur utilisation. Cela permet d’identifier les points critiques (ex : macros Excel indispensables à tel service) et de définir un plan de migration outillage par outillage. On peut prioriser les logiciels dont l’équivalent libre est le plus mûr ou ceux qui coûtent le plus cher en licence.
- Phasage progressif : éviter le big bang. Il vaut mieux remplacer une brique à la fois ou un périmètre à la fois. Par exemple, migrer d’abord le stockage de fichiers vers Nextcloud (ce qui n’impacte pas trop les habitudes bureautiques), puis la suite Office, puis le système d’exploitation en dernier. Entre les phases, laisser le temps aux agents de s’approprier les outils. Une transition progressive garantit la continuité de service et permet d’ajuster le tir en cours de route si nécessaire.
- Double usage temporaire : pendant la bascule, il peut être utile de maintenir en parallèle l’ancien système pour certains utilisateurs ou certaines tâches, le temps que tout le monde soit à l’aise avec le nouveau. Par exemple, conserver quelques licences Office pour les fichiers complexes le temps de convertir des macros vers LibreOffice, etc. Cette cohabitation doit toutefois être transitoire pour ne pas freiner l’adoption.
- Formation et support utilisateurs : c’est l’élément clé de la réussite. Un adage circule : « Sans accompagnement, c’est l’émeute ! ». Il faut prévoir des actions de formation pour les agents (ateliers de prise en main de LibreOffice, tutoriels pour utiliser Nextcloud, etc.), ainsi qu’un support renforcé en interne lors des premiers mois (disponibilité d’une équipe assistance, création de guides, FAQ). La sensibilisation aux enjeux de souveraineté numérique peut aussi motiver les troupes : expliquer pourquoi on change peut donner du sens et susciter l’adhésion, plutôt qu’un changement perçu comme purement technique. Avec un bon accompagnement, on constate généralement que les utilisateurs s’adaptent vite et que les réticences initiales s’estompent.
- Appui d’experts et de prestataires spécialisés : les collectivités ne sont pas seules face à ce défi. Un écosystème de sociétés de service spécialisées en open source existe pour les aider. Faire appel à ces experts permet d’obtenir du conseil, de l’assistance technique (pour migrer les données, paramétrer les nouveaux systèmes) et parfois du développement sur mesure pour adapter l’outil aux besoins spécifiques. Par exemple, la région Occitanie a travaillé avec un éditeur français (eXo Platform) pour remplacer Microsoft 365 par une plateforme collaborative open source, ce qui lui a permis de migrer sereinement tout en ayant un support professionnel. De même, le projet Territoire Numérique Ouvert à Lyon a bénéficié d’une subvention de l’État et mobilisé plusieurs entreprises locales du numérique (plus de 50 % des marchés attribués à des sociétés en région Auvergne-Rhône-Alpes, 100 % à des sociétés françaises) pour co-développer la solution. S’unir et collaborer avec d’autres collectivités via des associations (ADULLACT, etc.) ou des structures mutualisées (SITIV, etc.) est aussi un excellent moyen de partager les coûts et les connaissances.
En suivant ces principes, la transition peut se faire sans perte de productivité ni interruption du service public. La région Occitanie témoigne par exemple que ses utilisateurs ont adopté avec succès la nouvelle plateforme collaborative, appréciée pour son ergonomie, et qu’au final le service rendu est resté performant. Le mythe de la « catastrophe assurée » en quittant Microsoft est en train de s’effondrer : au contraire, bien préparée, la migration vers l’open source peut être un succès exemplaire.
Bénéfices et risques d’un passage à l’open source
Pour récapituler, faisons le point sur les principaux gains attendus d’une telle transition, ainsi que sur les risques ou écueils à surveiller.
Les bénéfices majeurs :
- Souveraineté et conformité : Reprise de contrôle sur les données et les outils, élimination du risque de voir des données sensibles aspirées par une puissance étrangère. Hébergement local ou national garantissant le respect du RGPD et des normes de sécurité nationales. On n’est plus prisonnier des lois extraterritoriales comme le Cloud Act.
- Indépendance technologique : Fin du verrouillage fournisseur. La collectivité n’est plus à la merci des changements de politique ou des hausses de prix d’un éditeur unique. Elle peut faire évoluer ses outils comme elle l’entend (code source ouvert) et changer de prestataire de support si besoin – ce qui introduit de la concurrence saine là où le monopole régnait.
- Économies financières : Réduction notable des coûts de licences. Par exemple, la région Occitanie a divisé par quatre sa facture annuelle en remplaçant Microsoft 365 par une solution open source. De son côté, le Land de Schleswig-Holstein estime qu’il économisera des dizaines de millions d’euros à moyen terme en abandonnant Microsoft. Même s’il faut investir au départ (formations, migration), l’investissement est rentabilisé sur la durée par l’absence de redevances logicielles récurrentes.
- Allongement de la durée de vie du matériel : Les systèmes libres (Linux, suites libres) sont souvent moins gourmands en ressources ou permettent d’optimiser l’existant, d’où une durée de vie prolongée pour les PC. Lyon a explicitement mis en avant cet objectif de prolonger ses équipements pour réduire son empreinte environnementale. En effet, ne plus être forcé de suivre le cycle imposé (ex : remplacement de PC car Windows 10 n’est plus supporté) permet d’éviter du gaspillage et de réduire les déchets électroniques.
- Transparence et confiance : Code source auditable par tous, ce qui renforce la confiance du public dans les services numériques. La population peut savoir quels algorithmes traitent leurs données, et même des développeurs locaux peuvent contribuer à améliorer les outils publics. Cela crée une dynamique citoyenne positive autour du numérique.
- Innovation et développement local : En faisant travailler des acteurs locaux sur des projets open source, les collectivités stimulent l’économie locale du numérique. Lyon a attribué la moitié de son projet collaboratif à des entreprises de sa région. On assiste ainsi à la création d’un cercle vertueux : l’argent public investi reste en grande partie dans le tissu économique local, et le produit développé peut être réutilisé ailleurs (logique de communs numériques). De plus, les équipes internes gagnent en compétence en participant à ces projets.
- Interopérabilité et standards ouverts : Fini les formats fermés qui créent des incompatibilités (combien de collectivités ont souffert de documents Word impossibles à ouvrir dans une ancienne version…). Avec l’open source, l’adoption de standards ouverts (tels que le format OpenDocument/ODF pour les textes, tableurs, etc.) assure une meilleure interopérabilité entre les systèmes et sur la durée. On peut dialoguer plus facilement avec d’autres partenaires, et même les citoyens peuvent utiliser des formats ouverts pour leurs démarches.
- Sécurité renforcée : Contrairement au cliché du « logiciel libre non sécurisé », de nombreux projets libres sont extrêmement sûrs grâce à la réactivité de leur communauté. Les failles peuvent être identifiées par des milliers d’yeux et corrigées rapidement, sans attendre le bon vouloir d’un éditeur. Par ailleurs, on élimine le risque de porte dérobée cachée dans un code propriétaire. Bien sûr, il faut mettre en place une politique de mises à jour régulières, mais c’est aussi le cas avec des logiciels propriétaires.
Les risques et défis :
- Résistance au changement et conduite du projet : C’est sans doute le principal défi. Changer les habitudes de travail de milliers d’agents publics ou d’employés est un chantier humain délicat. Si le projet est imposé sans pédagogie ni accompagnement, il peut échouer face aux réticences (« Pourquoi changer ce qui marche ? ») ou par découragement des utilisateurs. Il est donc crucial de prévoir un volet d’accompagnement solide (comme évoqué plus haut). Cela demande du temps, de la communication et du soutien de la hiérarchie. Le risque sinon est une fronde interne ou une démotivation, ce qui peut paralyser le bon fonctionnement des services.
- Compatibilité des fichiers et fonctionnalités spécifiques : Même si les suites libres lisent les formats Microsoft, il peut subsister des problèmes de mise en forme sur des documents Office complexes (par exemple des macros Excel très élaborées, des documents Word avec VBA, etc.). Ces cas particuliers doivent être anticipés. Parfois, il faudra adapter les macros dans LibreOffice ou trouver des solutions alternatives. Les outils métiers périphériques (ex : un logiciel qui s’interface avec Excel via des macros) peuvent aussi ne plus fonctionner tel quel. Il faut donc prévoir soit de conserver quelques postes avec Office pour ces usages précis, soit de financer le développement de nouvelles macros/scripts compatibles. Autrement dit, la transition technique doit être étudiée en détail pour éviter les pertes de données ou de fonctionnalités critiques.
- Montée en compétence et support technique : Passer à l’open source implique d’internaliser plus de compétences ou de s’appuyer sur de nouveaux prestataires. On ne peut plus appeler la hotline Microsoft en cas de souci ; à la place, il faut soit avoir une équipe technique interne capable de comprendre et résoudre les problèmes, soit un contrat de support avec une société open source. Cela nécessite potentiellement des formations techniques pour les équipes IT, et une réorganisation du support. Ce n’est pas forcément un inconvénient (on gagne en maîtrise), mais c’est un changement à bien gérer. Le risque sinon est de se retrouver bloqué sur un bug faute de savoir qui peut le corriger rapidement.
- Choix et pérennité des solutions : L’écosystème libre est foisonnant, ce qui est positif, mais cela implique de choisir les bons outils (ceux qui seront pérennes, bien supportés, évolutifs). Une collectivité pourrait être tentée par un petit logiciel libre très innovant, mais si la communauté derrière est minuscule ou le projet peu actif, il y a un risque de pérennité. Il faut donc évaluer la viabilité à long terme des solutions (communauté active, versions à jour, intégrateurs disponibles…). En pratique, les collectivités pionnières se tournent vers des projets déjà éprouvés (LibreOffice, Linux, Nextcloud, etc.) justement pour minimiser ce risque.
- Coûts de transition à court terme : Paradoxalement, si les économies sont au rendez-vous ensuite, il ne faut pas négliger que migrer a un coût initial. Déployer de nouveaux serveurs, migrer des dizaines de milliers de comptes utilisateurs, convertir éventuellement des fichiers, former les agents – tout cela représente un investissement. Il peut être significatif (plusieurs millions d’euros pour une grande ville par exemple). Il faut donc un soutien financier et politique fort au départ. De plus, pendant la transition, certains coûts sont doublés (on paye encore les anciennes licences le temps du chevauchement, tout en finançant le nouveau). C’est un passage obligé, mais qu’il faut planifier budgétairement. Le risque sinon est d’avoir une pression financière qui vienne interrompre le projet en cours de route.
- Risques organisationnels et politiques : Un projet de cette ampleur doit absolument avoir le soutien de la direction et des élus. Si un changement de majorité politique ou de direction survient et que le soutien disparaît, le projet peut être remis en cause. On se souvient du cas de la ville de Munich qui, après des années en Linux, était partiellement revenue en arrière suite à un changement politique. Ce genre de revers peut arriver si la décision n’est pas solidement ancrée ou si les utilisateurs se plaignent trop. D’où l’importance d’aligner tout le monde sur les objectifs (souveraineté, économies) et de marquer des succès rapides pour valider la démarche.
En somme, les risques liés à l’abandon des GAFAM sont gérables à condition d’anticiper et d’accompagner la transition. Les bénéfices, eux, sont de taille et s’inscrivent dans une vision à long terme. Pour beaucoup de collectivités et d’organisations, le jeu en vaut largement la chandelle. Comme le souligne Dirk Schrödter, ministre du Numérique du Schleswig-Holstein, les développements géopolitiques et les enjeux de souveraineté ont rendu cette stratégie non seulement souhaitable, mais nécessaire : « Les développements récents ont renforcé l’intérêt pour notre approche, surtout en Europe ».
Conclusion : vers un numérique plus libre et souverain
Le mouvement de fuite des collectivités locales hors des solutions des géants du numérique ne fait que commencer, mais il s’accélère nettement en 2024–2025. Des villes comme Lyon, des régions comme l’Occitanie, des pays comme le Danemark ou l’Allemagne… tous ces exemples montrent qu’il est possible de “reprendre la main” sur ses outils numériques en choisissant l’open source, sans sacrifier l’efficacité du service. Au contraire, avec une stratégie bien menée, les organisations y gagnent en autonomie, en flexibilité et en maîtrise budgétaire.
Bien sûr, chaque transition aura ses défis, ses imprévus, mais l’important est que la dynamique est lancée. L’écosystème open source n’a jamais été aussi mature pour offrir des alternatives crédibles aux suites des GAFAM. Il appartient maintenant aux décideurs (élus, DSI, dirigeants) de vaincre la peur du changement et d’oser faire le pas, soutenus par une communauté et des experts prêts à les aider.
En France, le discours sur la souveraineté numérique s’est traduit ces derniers mois par des actions concrètes : subventions pour développer des outils libres, labels (comme Territoire Numérique Libre) récompensant les collectivités engagées, mutualisation des efforts via des groupements d’intérêt public, etc. Tous ces signaux indiquent que l’open source a le vent en poupe dans le secteur public et au-delà.
En choisissant les logiciels libres, collectivités et entreprises investissent dans un avenir numérique durable et éthique, où elles gardent le contrôle et où la valeur créée profite à l’ensemble de l’écosystème local. C’est un pari sur l’avenir qui, de toute évidence, a déjà commencé à porter ses fruits (coûts réduits, innovation accrue, satisfaction des utilisateurs).
Il reste du chemin à parcourir, mais la tendance est là : la « dépendance par défaut » aux GAFAM n’est plus une fatalité. On assiste à l’émergence d’un numérique plus libre, souverain et collaboratif, au service direct des besoins des territoires et de leurs habitants. Et si votre organisation n’a pas encore envisagé ce virage, il n’est pas trop tard pour se poser la question – de nombreuses ressources et retours d’expérience sont disponibles pour vous accompagner.
Merci de votre lecture, et n’hésitez pas à partager vos expériences ou questions sur ce sujet passionnant de la souveraineté numérique et de l’open source. Ensemble, continuons à construire un écosystème numérique plus ouvert et maîtrisé ! 🚀
Sources